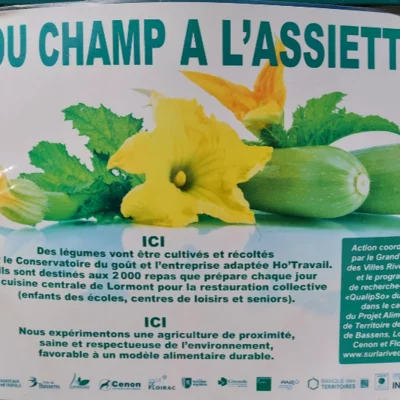Accessibilité
Les politiques publiques de l'alimentation et de santé de l’État et de la Région, ont pour objectifs communs : favoriser une alimentation saine et durable, et la diversification des lieux d’achats. Pour y répondre, elles motivent la mise en place d'actions pour la connaissance et la compréhension des facteurs qui influencent l’acte de consommation alimentaire. Elles soutiennent aussi le dépoiement de nouveaux moyens de distribution afin de favoriser l'accés à ces denrées alimentaires par toutes et tous.
> Les orientations de l'État
Le pôle prévention et promotion de la santé de l’Agence Régionale de Santé (ARS) s’appuie sur deux documents fondateurs :
- le Programme National Nutrition Santé (PNNS)
- les Plans Régionaux santé environnement (PRSE), fiche action 13 : favoriser l’accès pour tous à une alimentation saine et durable
Dans ce cadre, deux approches sont plébiscitées :
- les actions permettant au consommateur de faire le choix libre, positif et éclairé d’une alimentation saine et durable ;
- le principe de précocité : les actions réalisées sur un public jeune ont plus d’impact sur le long terme. Ainsi, dans la mesure du possible, l’éducation nutritionnelle et alimentaire doit se faire le plus tôt possible dans la vie du consommateur ;
- le principe de vulnérabilité : l'accent est mis sur la promotion d'une nutrition satisfaisante auprès des groupes défavorisés.
On retrouve par exemple :
- des actions permettant de développer des environnements favorables à l’échelle de la collectivité, d’un quartier ou d’un établissement. Cela peut se faire à la croisée avec la politique de la ville destinée aux quartiers prioritaires (QPV), et en milieu rural, avec le programme de revitalisation Petite Ville de Demain (PVD) ;
- des actions éducatives et de sensibilisation avec une pédagogie basée sur le renforcement des compétences psychosociales et favorisant une image positive de soi, de son corps, etc.
En effet, les démarches territoriales (Contrats locaux de santé, Projets alimentaires territoriaux, collectivités actives du PNNS, etc.) permettent de conjuguer ces deux types d’actions.
> Les orientations de la Région Nouvelle-Aquitaine
La stratégie de la direction de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’innovation sociale s’appuie sur quatre documents fondateurs.
- La feuille de route Neo Terra (2019) qui vise à accélérer l’économie des transitions. Elle comporte plusieurs ambitions sur l’alimentation : transition agro-écologique, déchets, préservation des ressources et des terres, favoriser l’engagement citoyen, etc.
- Le schéma régional de développement économique (SRDEII), est la déclinaison opérationnelle de la feuille de route pour les transitions Néo Terra. Cette stratégie économique accompagne les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs de performance et de souveraineté sous l'angle des transitions.
- Le plan de transition (2020) qui est décliné en stratégies régionales et en action pour les filières. On retrouve notamment l’action visant à « structurer les pratiques à forte utilité sociale et écologique en faveur d’un mode d’alimentation plus sain et solidaire ».
- Le Pacte Alimentaire (2021) et la feuille de route 2021-2025, traduisant notamment le domaine d’action « favoriser la solidarité et la citoyenneté alimentaire ».
Concernant les questions d’accessibilité à une alimentation saine et durable, trois approches sont proposées :
- Le développement des moyens d’accès à une offre alimentaire de qualité et de proximité à des prix accessibles pour tous ;
- L’intégration du consommateur dans la chaîne de production dont :
- l’intégration du public cible de l’action dans la construction des projets,
- des projets sur le développement du pouvoir d’agir et favorisant l’engagement citoyen,
- la sensibilisation des citoyens et des entreprises aux enjeux de l’alimentation (santé, environnement) et l’accompagnement au changement de pratiques,
- La mise en avant d’organisations collectives dans le mode d’entreprendre et d’envisager le développement économique.
On retrouve dans ce cadre des actions de type :
- L’accompagnement de structures associatives en faveur de l’organisation des habitants (groupements d’achats, supermarchés coopératifs, prix produits inférieurs, etc.) ;
- Des lieux dits “hybrides” (lieu de vie et de lien social, tiers-lieux nourriciers, café solidaires, épicerie et jardin solidaire, etc.) ;
- De nouveaux modes de livraison (épicerie café itinérante, plateforme numérique et appli producteurs consommateurs, initiatives de livraison de repas ou paniers en milieu rural, etc.) ;
- Des actions de sensibilisation.
> Une synergie État – Région
Les politiques publiques en faveur de l’émergence de productions et filières durables et de qualité participent à ces objectifs d’accès pour tous à une alimentation de qualité. Développer les filières et promouvoir les produits sous Signes d’Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO), c’est aussi les rendre plus accessibles à tous. En effet, l’augmentation de la part d’aliments Bio et SIQO, produits en circuit court ou en local, favorise leur consommation, et améliore leur impact sur l'environnement et la santé du consommateur. Néanmoins, il est important de souligner qu'un aliment produit localement, ou issu de circuits courts, n'est pas forcément durable et de qualité.
Dans la Loi Egalim I, le ministère définit les “produits durables et sous signes de qualité” comme les produits possédant :
- le label agriculture biologique (Bio)
- le Label Rouge
- l’appellation d’origine protégée (AOP) et d'origine contrôlée (AOC)
- l’indication géographique protégée (IGP)
- la spécialité traditionnelle garantie (STG)
- les démarches complémentaires comme : haute valeur environnementale (HVE) et le label Bleu-Blanc-Coeur
- les mentions valorisantes encadrées comme : « montagne», « fermier » , « issu d’une exploitation de haute valeur environnementale », etc.
Côté Région, c’est l’Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) qui est chargée du développement, de la promotion et du suivi de ces filières. Et les filières spécialisées par : INTERFEL, INTERBEV, CRIEL
Côté État, c’est l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). L'ADEME complète également ces actions en déployant différents outils de sensibilisation comme : écobalyse pour calculer l'impact carbone de son alimentation, sa page Comprendre, s'inspirer, agir à destination des citoyens, la page aux entreprises, la page aux collectivités et porteurs de PAT.
Concernant l’Agriculture biologique, c’est INTERBIO qui assure la structuration et la promotion de la filière biologique pour appuyer son essor.