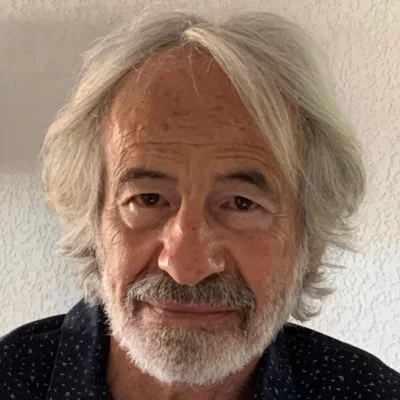On peut aborder les impacts de la coopération locale sur l’accès à l’emploi selon différents points de vue : les acteurs et leur rôle ; les dispositifs et leur conception ; le public et ses caractéristiques ; les modalités pédagogiques et leurs spécificités. En somme, on peut chercher à objectiver des processus afin de les modéliser et peut être de les dupliquer. L’histoire nous montre, et la rencontre du 19 septembre 2025 l’illustre, que les effets de cette coopération sur l’emploi ne s’analysent pas uniquement dans des données statistiques illustrées par des courbes et des histogrammes. Derrière les chiffres, il y a des personnes. Et derrière la perte d’emploi (et la recherche qu’elle implique), il y a des effets dominos, des doutes, des colères, qui ne relèvent pas de la seule rationalité, mais bien du ressenti. Les chiffres disent peu de choses sur ces histoires. Il est pourtant essentiel de les écouter, de leur prêter une réelle attention.

La coopération locale pour faciliter l'accès à l'emploi #2 : quand ce qui se compte n’est pas toujours ce qui compte
André Chauvet est expert - formateur dans le domaine de la professionnalisation des acteurs de l'emploi. Il nous livre son regard sur la rencontre du 19 septembre 2025 dédiée à la coopération entre les acteurs locaux pour faciliter l'accès à l'emploi.
Des histoires à écouter ?
Car nos coopérations sont à analyser dans les avancées qu’elles permettent à des femmes et des hommes. La dynamique d’un territoire est aussi liée à ces synergies ainsi provoquées. Ce qui anime l’ensemble des acteurs, c’est la possibilité de sortir des « a priori » sur le public pour co-écrire des histoires alternatives qui nous touchent bien sû,r et nous encouragent aussi à poursuivre nos chantiers collectifs, quels que soient nos rôles. Ainsi, on peut laisser de côté, pour un temps, les courbes en portant attention à la réalité du vécu des personnes. Sur ce plan, nous avons tous fait l’expérience le 19 septembre 2025 de la puissance émotionnelle du théâtre dans ce qu’il donne à sentir des impacts, allant de l’espoir à la détresse. Mais également dans ce qu’il permet de comprendre que l’on peut parfois oublier : les personnes sont situées dans des environnements humains où leur situation a aussi des conséquences. Nous sommes des êtres d’interrelation. Nous mesurons également l’importance d’une parole authentique d’une personne animée par l’énergie, la patience et la persévérance. Sur ce plan le témoignage de Ghizlane fut intense et éclairant. Et celui de la professionnelle qui la soutient, sans jugement, en appui, présente et facilitante, le fut également. Car pour chaque personne, rien n’est vraiment simple : les aléas à surmonter sont multiples et pas toujours prévisibles. Il s’agit ainsi de resituer le partenariat dans sa dimension subjective et humaine, dans la richesse de la différence, dans la solidarité qu’il construit.
Les histoires sont donc puissantes tant pour témoigner que pour garder le cap collectif : les personnes ont plus de ressources que l’on pense parfois qu’elles en ont. Ce sont les occasions de le prouver qui leur manquent parfois. À nous de fabriquer ces occasions ?
Des croyances qui nous limitent ?
Et justement, que se perd-il si vite quand l’emploi paraît inaccessible? D’abord, la confiance. En soi, dans sa capacité à avancer. Dans les autres aussi, dans la modification du regard qu’ils peuvent porter sur nous. Mais peut-être aussi avons-nous des certitudes qu’il nous faut questionner : nous saurions, à l’avance, ce que les personnes doivent faire pour accéder à l’emploi. Se conformer à des attendus ? Lever des freins que nous avons identifiés pour elles ? Ce qui apparaît, c’est surtout que les priorités des personnes leur sont propres, leurs limites réelles ou imaginées aussi, leurs talents bien sûr également. C’est donc d’humilité et de dialogue dont il faut se doter. Nous l’avons bien compris dans les démarches d’aller vers. Nous ne savons pas vraiment ce qui peut se construire quand on sort de nos propres repères, de nos bureaux. On doit esquisser en situation des relations et faire ce qui convient avec les personnes. Et pas toujours ce qu’on avait prévu. Cela génère des doutes, bien sûr. Mais nos doutes sont des ouvertures, car ils ne cataloguent pas les personnes. Ils permettent d’avancer au regard des enjeux de toutes et tous.
Le dialogue comme ressource et la persévérance comme boussole ?
Alors, si on se méfie de nos propres certitudes, cela implique de poser comme principe la nécessité de mettre en délibération nos désaccords et nos différences, mais également nos rôles et nos enjeux différents. Ces enjeux, s’ils sont légitimes, peuvent être dépassés si nous parvenons à nous accorder sur l’essentiel : les personnes, leur dignité et leur humanité. Mais également sur le souci de prendre soin tant des personnes que des territoires. Nous pouvons donc nous accorder plus vite que nous le pensons sur ce qui nous réunit : dialoguer suppose d’accepter déjà que nous puissions avoir des désaccords. Mais c’est aussi accepter que le point de vue des autres puisse nous influencer et que nous ne puissions rester dans une position dogmatique non discutable. Le dialogue est une école de la patience et du respect. Nous l’avons perçu dans les initiatives autour de « territoires zéro chômeur », tant dans des projets initiés, non encore totalement aboutis que dans celles qui étaient en cours depuis longtemps (exemple de Castillon-la-Bataille en Gironde). Et la persévérance est aussi liée aux personnes que nous avons embarquées dans nos projets. Les oscillations et incertitudes sur les financements s’expliquent, mais du point de vue des personnes, elles sont difficiles à « encaisser ». Alors cela nous incite à chercher d’autres solutions, à continuer à tisser notre toile et à poursuivre le chemin.
La robustesse plus que la performance à tout prix ?
Alors, si on combine les différents éléments présentés ci-dessus, peut-on dessiner une approche de la coopération territoriale qui porterait son attention sur le travail pour toutes et tous, non seulement pour d’évidentes raisons économiques et humaines, mais également comme levier de transformation et de robustesse des territoires ? Si j’utilise le mot robustesse, en référence aux travaux d’Olivier Hamant, c’est qu’il permet de mieux comprendre comment articuler la performance (un résultat optimisé) avec les enjeux d’équilibre à court terme et de viabilité à long terme : faire aussi que le territoire « tienne », résiste, aussi parce que les personnes qui y vivent l’animent. Les initiatives présentées lors de la rencontre montrent l’importance d’un processus structuré où tous les acteurs peuvent être parties prenantes, notamment les personnes concernées par l’accès à l’emploi. Mais elles montrent également la nécessité d’un dialogue permanent et l’importance de se fédérer autour d’une perspective commune. C’est en ce sens que la viabilité intervient. Ce qui est mis en place peut contribuer à des solutions d’emploi, évidemment, mais au-delà, à des effets « immatériels » très essentiels : lien social, sentiment d’appartenance, sentiment de contribution à une aventure collective féconde et plus largement espoir que les efforts conjugués auront un pouvoir de transformation.
Cela réinvite dans le débat les questions d’évaluation. Au-delà de la performance (nos fameuses statistiques évoquées en préambule), peut-on compléter l’analyse des démarches proposées dans des approches plus préventives (faire en sorte que le lien social et les rencontres se développent) et aussi des impacts immatériels difficiles à quantifier justement parce qu’ils sont de l’ordre du vécu, de l’éprouvé? Ce qui nous ramène au début de notre propos. Ce ne sont pas seulement des mesures, des dispositifs, des outils, des méthodes : ce sont aussi des rencontres et des vies. Et cela relève au moins autant de l’histoire à écouter que du tableur à analyser.
Et puis, des histoires transformatrices ?
Nous savons aussi que la période est difficile : tensions sur les financements, doute sur la pérennité des structures et des dispositifs, concurrence possible entre acteurs. La croyance dans la justice sociale n’empêche pas une nécessaire lucidité sur les tensions du moment. L’énergie et l’inventivité déployées par les différents acteurs sur les territoires produisent des impacts au quotidien. L’insertion par l’activité économique (témoignage éclairant de l’INAE) et, plus largement, les projets portés par les structures de l’Économie sociale et solidaire que nous avons entendus témoignent de cette pertinence d’action. Elles permettent de changer et d’améliorer la vie des personnes accompagnées ; de légitimer et reconnaître la qualité du soutien des personnes impliquées dans l’accompagnement. Mais il y a d’autres impacts. Ces histoires peuvent progressivement devenir d’autres modèles, des alternatives puissantes aux discours dominants sur les freins et l’employabilité. Et sur le territoire également comme lieu de vie qui peut s’en trouver revitalisé. Des sortes d’impacts à entraînements progressifs ? Les nombreuses expérimentations menées depuis des années nous éclairent sur des principes d’action vertueux à traduire et adapter par les acteurs de terrain. Leur capacité d’initiative est centrale.
En somme, on peut raconter les impacts du partenariat sur l’emploi autrement. Comme une aventure collective. Pour donner crédit à la formule : ce qui compte n’est pas toujours ce qui se compte. Ce qui suppose une vraie réflexion sur les modèles économiques de ces approches préventives. Le moment est propice. Car il y a urgence.