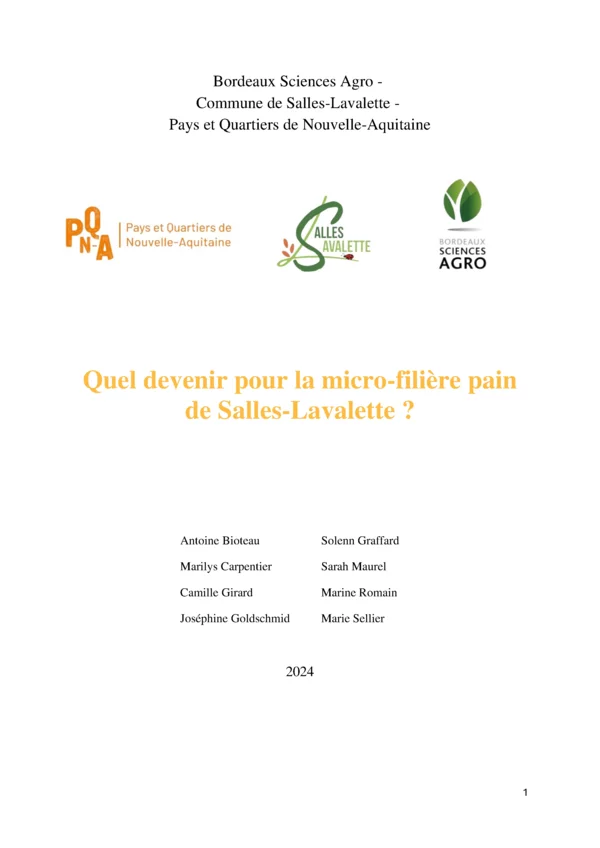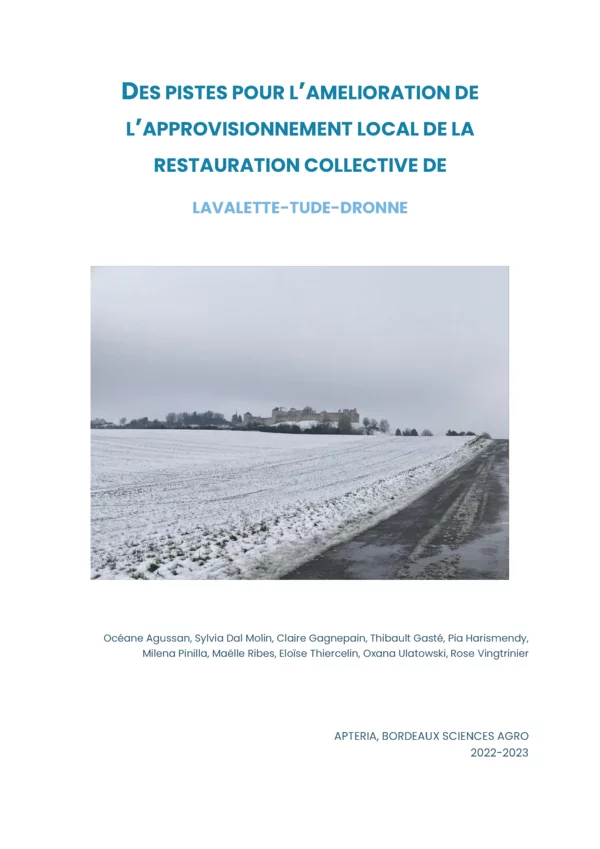Le dispositif d’expérimentation territoriale
Depuis 2021, PQN-A et Bordeaux Sciences Agro ont accompagné quatre territoires :
- le syndicat Mixte Est-Creuse Développement sur la structuration d’une filière locale de noisette
- la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (79), sur les conditions de structuration d’une filière locale de légumes
- la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne (16) sur des scénarios d’approvisionnement local de la restauration collective publique, sans perturbation du tissu économique local existant
- la commune de Salles-Lavalette (16) sur le renforcement et le développement d’une micro-filière pain
- la communauté de communes Mellois en Poitou sur la structuration des filières locales ovine et bovine (79) (restitution à venir d'ici 2026)
Retrouvez dans cet article la synthèse et le replay du webinaire de restitution des deux dernières expérimentations territoriales, avec le témoignage de Brigitte Ricci, première adjointe à la Maire de Salles-Lavalette, et Chantal Goreau, Vice-Présidente chargée des affaires scolaires à la communauté de communes (CdC) Lavalette Tude Dronne.
Un dispositif gagnant-gagnant
Chaque année depuis 2021, un territoire sélectionné par un jury composé de la Région, la DRAAF, l’ADEME et l’ARS suite à un appel à manifestation d'intérêt, bénéficie de l’expérimentation territoriale. Une cohorte d’étudiantes et étudiants de deuxième année du Master APTERIA de Bordeaux Sciences Agro, se penche sur une problématique identifiée par le territoire, qui a trait à la relocalisation d’une agriculture et d’une alimentation saine et durable. L’ambition est triple : permettre à un territoire sélectionné de bénéficier de l’expertise scientifique de BSA et de l’accompagnement de PQN-A sur un projet concret, fournir un terrain d’expérimentation à des étudiantes en formation, et diffuser à l’ensemble du réseau un retour d’expérience via des outils de vulgarisation.
Une méthodologie adaptée au développement territorial
Une fois la problématique formulée par le territoire, les étudiantes réalisent une première exploration du sujet via la littérature scientifique et “grise”, et des entretiens de cadrage. Une fois ce travail terminé, elles et ils reformulent au territoire et à des acteurs ressources la problématique, et proposent une liste d’acteurs à rencontrer. Vient ensuite la semaine de “terrain”, durant laquelle de nombreux entretiens sont réalisés. Après l’analyse de cette “matière première”, les étudiantes, avec l’appui de PQN-A et en concertation avec la collectivité, peuvent proposer un atelier de co-construction avec des acteurs, avant de présenter en séance plénière les résultats de leurs travaux. Lors de la session de restitution, les étudiantes animent des ateliers avec l’appui de PQN-A, afin de permettre aux acteurs de s’emparer directement des résultats des travaux.